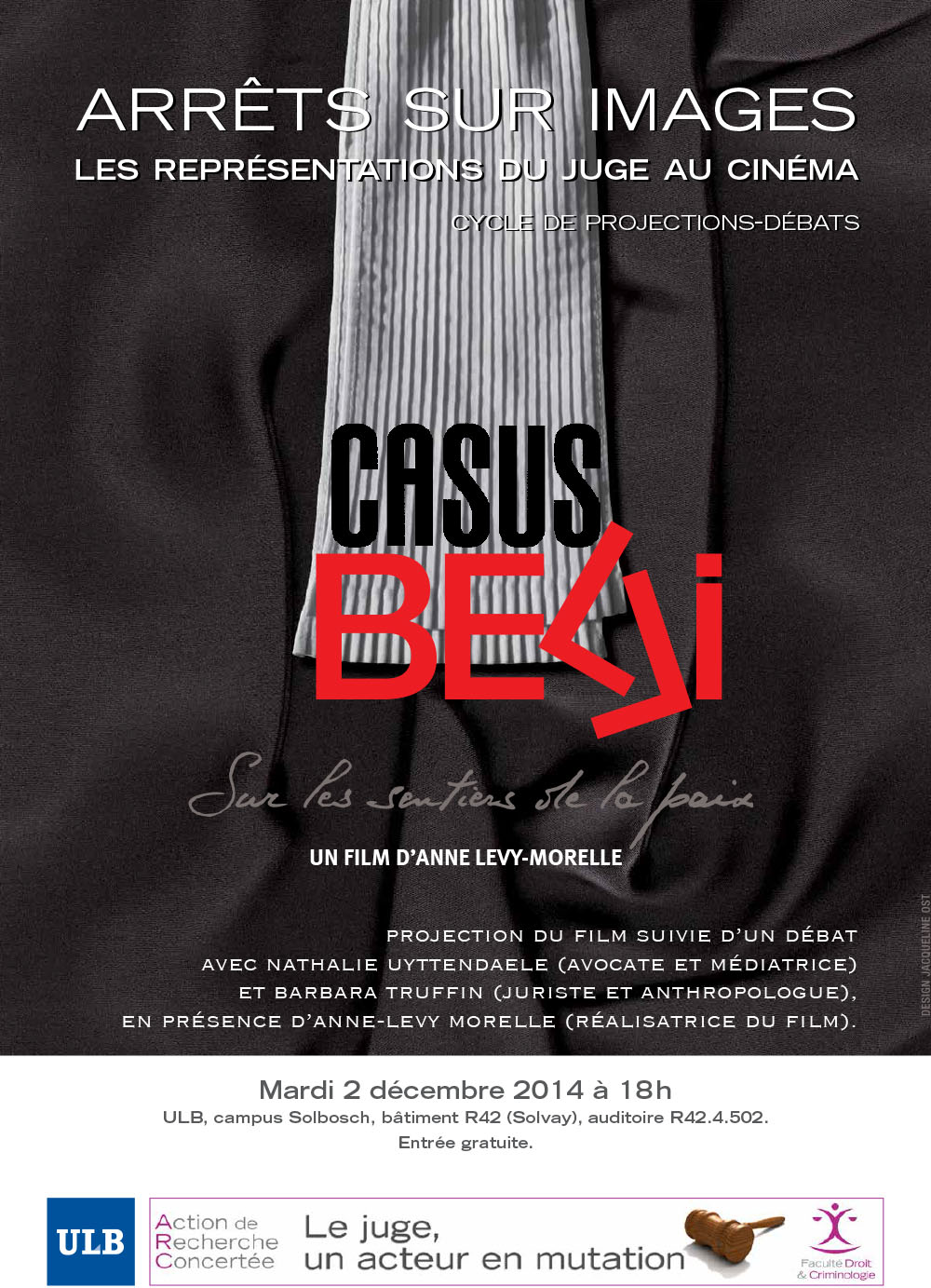Le voile et la notion de discrimination
Depuis l’ordonnance du Tribunal du travail de Bruxelles condamnant la STIB à la suite de son refus d’engager une candidate voilée, on reparle beaucoup de l’interdiction du port du des signes convictionnels dans les services publics.
Je n’entends pas commenter la stratégie de la STIB, qui me semble peu lisible. Par contre, si on retient la question générale de l’interdiction du port de signes convictionnels par des agents des services publics, on peut noter que l’ordonnance relative à la STIB mobilise à ce propos les notions de discrimination directe et de discrimination indirecte, sans que cela fasse cesser les polémiques. J’aimerais simplement faire part, ici, de mes interrogations sur la manière dont ces notions peuvent être mises en œuvre dans ce débat.
Partons du fait que la STIB a été condamnée pour discrimination directe fondée sur la conviction religieuse. Si une personne n’est pas recrutée par un service public parce qu’elle refuse de retirer son signe religieux visible dans l’exercice de ses fonctions, peut-on en conclure qu’elle a été discriminée en raison de sa religion ? Ce serait le cas si l’employeur rompait le processus de recrutement du simple fait d’avoir pris connaissance de la conviction du candidat, et ce serait inadmissible. Mais si l’employeur rappelle que la neutralité des services publics se traduit par une interdiction générale de tout signe convictionnel visible (politique, philosophique ou religieux), et que le candidat annonce qu’il veut malgré tout porter un tel signe dans l’exercice de ses fonctions, son non-engagement ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion, c’est-à-dire un traitement inégalitaire en fonction d’une conviction déterminée, mais la simple application d’un règlement en matière de neutralité d’un service public.
Bien entendu, si le candidat n’avait pas manifesté sa religion par un signe visible, il aurait pu être recruté. Mais cela ne prouve pas que sa conviction a motivé le non-recrutement : il n’y aurait de discrimination directe que s’il était écarté alors qu’il présente les compétences requises et qu’il s’engage auprès de son employeur à renoncer au port de son signe convictionnel.
Si tous les candidats qui veulent exhiber un signe convictionnel dans le cadre de leur travail sont écartés pour ce seul motif, on peut tout au plus parler de discrimination indirecte. On soupçonne une discrimination indirecte lorsqu’un dispositif apparemment neutre désavantage particulièrement, dans les faits, un groupe protégé par un critère établi par la loi (la prétendue race, le handicap, l’orientation sexuelle…). Cette incrimination est souvent évoquée à propos de l’interdiction du port de signes convictionnels, qui frapperait particulièrement les croyants. Mais, en l’occurrence, la STIB a subi une condamnation pour discrimination indirecte fondée sur le sexe, et ce reproche apparaît dans d’autres affaires.
Si on ne mobilise pas le sens juridique de cette notion, on peut la juger hors de propos. Un règlement qui interdit tout signe convictionnel frappe les femmes qui veulent porter le voile, mais ce n’est pas là la conséquence injuste et dissimulée d’une règle apparemment neutre, comme le suggère l’expression de « discrimination indirecte » : c’est la conséquence inévitable de l’application de la règle, qui interdit délibérément le port de signes convictionnels visibles quelles que soient les personnes concernées. L’empêchement occasionné est précisément ce que vise la règle incriminée.
Juridiquement, par contre, on peut soupçonner une discrimination indirecte si une telle règle a des effets particuliers sur un groupe protégé par un des critères retenus par les lois anti- discriminations. Au vu des inégalités régnant dans la société, le droit vise ainsi à préserver différents groupes de toute forme de discrimination, y compris indirecte, et les femmes font évidemment partie des groupes protégés. Or, s’agissant du voile, les chiffres sont là : ici et maintenant, ce sont, à une écrasante majorité, des femmes musulmanes qui sont gênées dans l’accès à l’emploi, qui est une condition nécessaire (quoique non suffisante) de leur indépendance.
Mais cela suffit-il pour conclure que les règlements interdisant les signes convictionnels excluent particulièrement les femmes ? Aller dans ce sens passe par une double focalisation : il faut s’attacher non pas aux femmes en général, mais aux femmes de confession musulmane ; et non pas aux femmes musulmanes en général, mais seulement à celles qui, au nom de leur compréhension de l’islam, veulent porter le voile sur leur lieu de travail. Cette opération fait naître un doute quant au fait qu’il y ait discrimination indirecte fondée sur le sexe : elle montre que ce n’est pas en tant que femmes que ces personnes sont écartées de l’emploi, mais en raison de leur choix de porter un signe convictionnel visible. Le hiatus entre les sexes ne permet pas de conclure que la politique d’interdiction des signes convictionnels est genrée : ce qui est genré, c’est la lecture de l’islam qui impose aux seules femmes le port du voile pour des motifs de pudeur. Si, aujourd’hui, l’interdiction des signes convictionnels frappe surtout des femmes, c’est en raison d’une distinction directe exercée au sein d’un courant convictionnel précis — de la même manière que, parmi les sikhs et les juifs, ce sont surtout les hommes qui doivent renoncer à porter un couvre-chef s’ils veulent accéder à certains emplois.
Ces remarques ne sont pas le dernier mot dans ce débat difficile. Concernant les inégalités subies par les femmes, il y a de bonnes raisons de mener une politique de l’emploi inclusive qui compense les discriminations subies par celles qui portent le voile, et qui se heurtent parfois à des règles formellement neutres établies dans le seul but de les écarter. Mais on peut aussi, toujours d’un point de vue féministe, refuser de protéger spécifiquement le port du voile, notamment par solidarité avec les femmes qui luttent contre son imposition forcée dans différents pays dirigés par des islamistes. Il y a là des choix politiques délicats, et la notion de discrimination est indispensable pour analyser les situations que l’on veut corriger. Mais c’est une raison de plus pour veiller à l’employer avec prudence dans le débat sur les signes convictionnels, afin qu’elle ne soit pas affaiblie par des usages qui font naître un doute quant à son bien-fondé.
Par Vincent de Coorebyter, professeur à l’ULB, paru dans « Le Soir » du 2 juin 2021
(*) Les propos exprimés dans le présent article n’engagent que son auteur