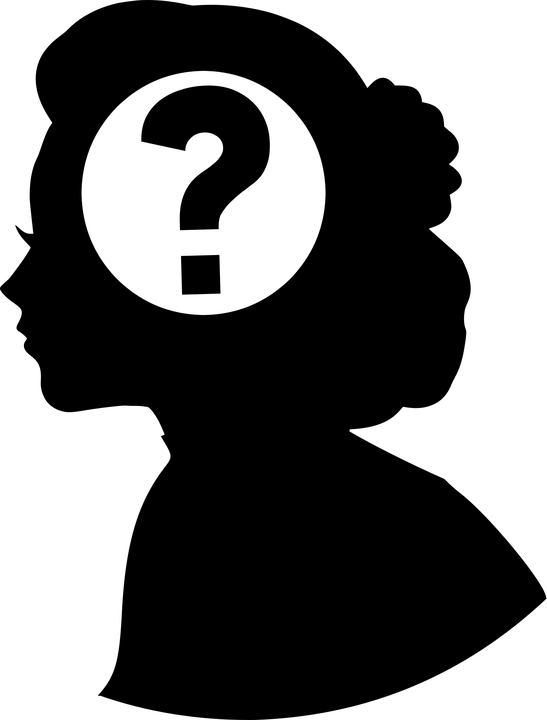La mécanique grinçante des primaires
En France comme aux Etats-Unis, l’année 2016 aura été marquée par l’organisation de primaires en vue de désigner des candidats à l’élection présidentielle. Le processus entre seulement dans sa phase active en France, avec la campagne de la primaire de la droite et du centre, qui sera suivie de plusieurs autres scrutins du même genre à gauche. Il est donc trop tôt pour tirer un bilan de ces différents processus, mais à ce jour il se présente sous des dehors plutôt sombres.
Nous ne saurons jamais ce qu’aurait donné la primaire républicaine aux Etats-Unis si Donald Trump n’y avait pas participé. Mais qu’il y ait pris part, et qu’il l’ait remportée, est un signal inquiétant. C’est un effet pervers des primaires que de permettre des candidatures farfelues ou dangereuses, qui auraient été balayées du revers de la main si le parti concerné avait choisi son candidat par une décision interne. Le principal mérite des primaires est de permettre à des outsiders de percer, voire de l’emporter, au détriment des décisions d’état-major : à ce titre, on pouvait se réjouir de la désignation d’Obama en 2008. Mais cette ouverture a un revers, dont on mesure aujourd’hui toute l’importance. Au vu de l’actualité américaine, il devient difficile d’affirmer que les primaires couronnent automatiquement le meilleur candidat, celui qui possède par excellence l’étoffe présidentielle.
A vrai dire, on l’avait déjà compris en France au vu de l’action très décevante de François Hollande, vainqueur de la primaire socialiste en 2011. Un des meilleurs arguments en faveur des primaires consiste à dire qu’elles ajoutent de la démocratie à la démocratie en permettant au peuple de voter deux fois au lieu d’une. Mais cela permet de se tromper deux fois : les fautes de jugement font partie du procédé électoral, et les primaires n’échappent pas à la règle.
On peut même se demander si elles n’induisent pas en erreur, en tout cas tendanciellement. Car les primaires mettent en concurrence, par définition, des candidats qui partagent un même horizon idéologique et qui s’adressent à une partie bien définie de l’électorat (même si ses contours sont plus ou moins larges selon les cas). De ce fait, elles ne sont pas le meilleur moyen de confronter des programmes et des idées : ce débat-ci intervient surtout au moment de l’élection elle-même, et il a souvent une certaine tenue parce qu’il oppose des projets de société radicalement différents entre eux. Lors des primaires, par contre, les candidats sont naturellement tentés, pour une partie au moins d’entre eux, de jouer la carte de la personnalisation et de la démagogie, de faire valoir leur tempérament (jusqu’à la caricature, parfois, chez les hommes) et de radicaliser leur discours pour se détacher de l’homogénéité ambiante. Les primaires n’ont évidemment pas inventé le populisme, qu’il soit de droite ou de gauche, mais elles y inclinent en contraignant les candidats à faire valoir leur différence coûte que coûte : en France, il suffit de voir comment Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire et François Fillon se profilent depuis quelques semaines pour s’en convaincre. Même Alain Juppé, qui avait décidé de jouer la carte du centrisme et de la raison, se radicalise par moments, bien conscient qu’il doit lui aussi donner des coups de menton. Où est le progrès pour la démocratie ? Comme le font remarquer beaucoup d’observateurs, la primaire de la droite française permet surtout à Marine Le Pen de voir ses idées confortées par ses concurrents et d’apparaître, en définitive, plus apaisée que certains candidats des Républicains – plus présidentiable, en somme.
Un autre mérite supposé des primaires est de donner un maximum de légitimité aux candidats qui les remportent : les vainqueurs se présentent à la présidentielle avec l’onction du peuple et non d’un parti, après que les primaires leur ont permis de gagner en notoriété et en crédibilité. C’est effectivement ce qui se passe lorsque des partis affaiblis ou peu structurés voient émerger, grâce aux primaires, une personnalité inattendue ou consensuelle. En Italie, ce fut le cas de Romano Prodi en 2005, lors d’une primaire commune à neuf partis de la gauche ou du centre qui a préparé sa victoire contre Silvio Berlusconi aux élections législatives de 2006. Mais lorsqu’une primaire est organisée par un parti puissant, elle risque de délégitimer la personnalité qui la remporte car celle-ci est critiquée, tout au long du processus, par ses propres amis politiques. On ne peut pas dire que les concurrents de Donald Trump lui ont tressé des lauriers au cours de la primaire républicaine, pas plus que François Hollande n’a été ménagé en 2011 (« gauche molle », dixit Martine Aubry), ou qu’Alain Juppé et Nicolas Sarkozy ne s’envoient des fleurs aujourd’hui. Gardez-moi de mes amis, disait Voltaire, je me charge de mes ennemis : les primaires peuvent être une formidable machine à décrédibiliser.
Il reste, et j’y reviens, l’argument démocratique en faveur des primaires : elles donnent au peuple le soin de choisir ses candidats aux plus hautes fonctions. Mais de quel peuple s’agit-il ? Selon Alexis Corbière, qui vient de publier un essai sur la primaire organisée par le parti socialiste français en 2011, l’électorat qui vote aux primaires n’est pas représentatif de la population visée : dans le cas étudié, il était plus diplômé, plus politisé et plus âgé qu’à l’élection proprement dite, et péchait par manque de participation des milieux populaires.
Il est vrai qu’Alexis Corbière est le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, qui refuse la procédure des primaires. Mais il ne faut pas être grand clerc pour imaginer toutes sortes de distorsions entre l’électorat qui est invité à participer à une primaire et les participants effectifs. Le risque est à la fois de voir les plus radicaux au sein d’un monde idéologique donné se déplacer davantage, mais aussi de voir des électeurs venant d’autres univers se mêler à la primaire, que ce soit par conviction (comme ce fut le cas pour Trump) ou par calcul (comme cela pourrait être le cas en France dans le but de faire battre Sarkozy par Juppé). L’implication des électeurs est positive en soi, mais les contours flous des primaires introduisent une dose d’ambiguïté dans leurs résultats – jusqu’au fait de voter, non pour le meilleur, mais pour celui qui est le mieux placé dans les sondages présidentiels proprement dits, ce qui a porté François Hollande en 2011.
** Billet paru dans Le Soir du 28 septembre 2016.