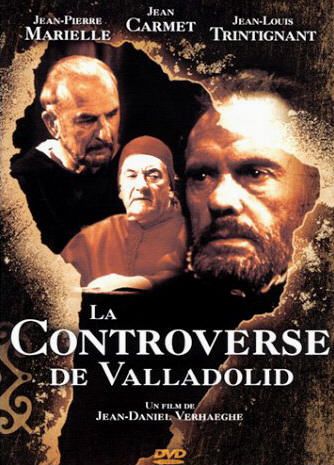Colère et tristesse
Par Marc Uyttendaele. Le 18 décembre, le Premier ministre a démissionné. Il s’est rendu chez le Roi pour y présenter la démission de son gouvernement. L’histoire était écrite. Sommé de solliciter la confiance de la Chambre des représentants, il s’y est obstinément refusé. Et paradoxalement, il l’a néanmoins implicitement demandée et se l’est vue refusée.
Son discours était fort et impressionnant. En théorie, il aurait mérité meilleur accueil. L’on ne peut reprocher, cependant, à ceux qui se sont opposés à lui pendant quatre ans de ne pas lui avoir prêté crédit. Tant dans la forme que sur le fond, la volte-face était trop saisissante. Sur la forme, voici un Premier ministre qui manifeste à l’égard du Parlement une déférence qui tranche avec l’attitude qui a été la sienne depuis le début de la législature. Sur le fond, son discours comprenait des inflexions progressistes en totale contradiction avec le conservatisme décomplexé qui a été l’empreinte de la politique menée depuis 2014.
Dès lors que les partis socialistes et écologistes avaient décidé de déposer une motion de méfiance, le Premier ministre a anticipé le vote de l’assemblée et a présenté sa démission au Roi. Nous voici revenu dans l’épure classique du fonctionnement de la démocratie belge : le gouvernement ne tombe jamais devant la Chambre et anticipe toujours, par sa démission, la sanction de celle-ci.
Le Roi a tenu cette démission en suspens.
Il va consulter les présidents de parti. Il ne faut pas être grand clerc pour deviner la suite de l’histoire. A l’exception de la N-VA, tous vont préconiser d’attendre le 26 mai pour organiser les élections. Tous vont appeler de leurs vœux un gouvernement en affaires courantes qui, de bonne intelligence avec le Parlement, prendra des mesures utiles au pays. Et cette option sera finalement retenue. Paradoxalement, la situation serait conforme à ce qu’a proposé le Premier ministre le 18 décembre, à la seule différence qu’elle apparaitra comme la conséquence de son échec, et non comme la manifestation d’une confiance qui lui aurait été accordée.
Le seul suspens résidera dans la question de savoir si ces mesures pencheront plutôt à gauche ou à droite. Le Premier ministre s’efforcera-t-il, comme il l’avait annoncé dans un premier temps, de finaliser les politiques conduites depuis quatre ans en obtenant le soutien de la N-VA ou, au contraire, assumera-t-il le virage à gauche qu’il a esquissé, dans un second temps, lors de son appel du 18 décembre ? Nul ne sait et il n’est pas impossible que les deux voies soient simultanément ou alternativement empruntées.
Cette crise laisse, cependant, un goût de cendres. Les cendres d’un système politique abîmé, exsangue.
La réputation du monde politique en est durablement affectée. Les citoyens supportent mal l’opportunisme, et plus mal encore la propension d’un responsable politique à tout faire – et parfois n’importe quoi – pour demeurer au pouvoir. A cet égard, la trajectoire récente du Premier ministre est navrante.
Le 4 décembre, à la Chambre des représentants, dans le cadre d’un débat parlementaire qu’il avait lui-même provoqué, pour éviter la chute de son gouvernement, il était prêt à toutes les concessions sur une question de principe – l’engagement de la Belgique à signer le Pacte de l’ONU pour les migrations – qu’il avait jugée lui-même essentielle. Ainsi se proposait-il de se rendre « à titre personnel » à Marrakech pour y dire la position du Parlement, et non celle de la Belgique. Le Parlement ne lui permit pas ce jeu de dupes.
Le 8 décembre, lors de la sortie – ubuesque sur la forme – des ministres N-VA du gouvernement, le Premier ministre ménageait ses ex-partenaires. Il envisageait le vote du budget et escomptait leur soutien à son gouvernement minoritaire.
Toujours, dans le but d’éviter une démission, il se refusa à solliciter le vote de confiance de la Chambre quand bien même cette règle s’imposait et que demande expresse lui en avait été faite par une majorité de membres de celle-ci.
Enfin, le 18 décembre, formellement avec un incontestablement brio mais de manière quelque peu pathétique, il mendiait le soutien de l’opposition pour mener une politique différente, sinon contradictoire avec celle qu’il préconisait encore dix jours plus tôt.
Malheureusement, le Premier ministre n’est pas le seul à livrer une image dépréciée.
Il existe, en effet, entre les différents partis, à l’exception notable de la N-VA, un large consensus pour ne provoquer d’élections anticipées et de limiter l’action du gouvernement aux affaires courantes.
Les arguments pour justifier cette option sont pauvres. Ils sont de quatre ordres.
Premièrement, il ne faut pas déranger trois fois l’électeur en un an. Absurde. Il s’agit-là d’une vision déprécier et médiocre de la démocratie. Celle-ci exige évidemment qu’en cas de paralysie de politique, la parole soit rendue au peuple.
Deuxièmement, le processus impliquerait un surcoût de 8 millions d’euros. Plus absurde et plus choquant encore. La démocratie n’a pas de prix et un tel montant est une goutte d’eau dans le budget de l’État.
Troisièmement, il est inutile de voter car aucun gouvernement fédéral ne verrait le jour avant le 26 mai 2018. Stupide. Il est possible que tel soit le cas, mais, dans cette hypothèse, le gouvernement actuel assurerait également l’expédition des affaires courantes. Autrement dit, la seule différence entre les deux situations est que l’on aurait donné la parole au peuple et que l’on se serait au moins donné une chance de résoudre la crise plus rapidement. Car il ne faut pas se leurrer. Après, les élections du 26 mai 2018, le risque est grand d’avoir une crise particulièrement longue avant que ne soit formé un nouveau gouvernement ou que de nouvelles élections doivent être organisées. On ajoute donc d’emblée six mois de plus avant d’avoir une chance de sortir du marasme dans lequel se trouvent les institutions fédérales.
Le quatrième argument, le seul qui ait quelque consistance, n’est jamais avoué. Tous ces partis supputent qu’ils ont de meilleures chances de succès en mai qu’en janvier ou février. Certains se trompent assurément car tous ne gagneront pas en mai 2018 et il n’y a rien de noble à refuser, par calcul, de se confronter immédiatement au jugement des électeurs.
En droit constitutionnel belge, la solution retenue est valide en droit. Il n’y a, en effet, aucune obligation juridique de coupler la démission d’un gouvernement et la dissolution des chambres. L’esprit et le respect du modèle démocratique, cependant, commandent qu’en cas de blocage institutionnel total – ce qui est le cas – la parole soit donnée aux électeurs. Telle est d’ailleurs la raison pour laquelle des élections générales ont été organisées en Espagne en décembre 2015 et en juin 2016. Telle est la raison pour laquelle les Suédois risquent d’être amenés à voter à deux reprises en quelques mois.
Des élections à répétition ne seront pas à exclure non plus en Belgique. La crise politique actuelle en est le germe. La N-VA a annoncé sa volonté, après les élections, de démanteler plus encore le modèle fédéral. A cette fin, il faudra une révision de la Constitution. A cette fin une déclaration de révision doit âtre adoptée sous l’actuelle législature. Or, on l’aura compris ces derniers jours, il existera sans doute une majorité de députés pour verrouiller le texte constitutionnel, rendre impossible toute réforme de l’État après les élections, et ainsi punir la N-VA pour ses méprisables dérives. Le pari est osé. En effet, si le 27 mai 2019, la N-VA est incontournable dans la constitution d’une majorité fédérale, la crise sera totale et il faudra sans doute, à plus ou moins bref délai se préparer à « déranger » les électeurs une nouvelle fois pour repenser de fond en comble une Belgique irrémédiablement délabrée.
Colère et tristesse.
Ces jeux politiques et constitutionnels renforcent le divorce entre le monde politique et une partie de l’opinion. Ils permettent de disqualifier la vie politique, de la dissocier des enjeux politiques majeurs – dans quelle société voulons-nous vivre ? – qui sont eu cœur des préoccupations de nombre de citoyens, ainsi qu’en témoignent la marche pour le climat ou le mouvement des gilets jaunes. Ce divorce entre la politique et la vie politique alimente le populisme et présente le danger extrême de conduire les citoyens à rejeter un modèle de société, consacré par les démocraties représentatives et enraciné dans un système de protection sociale, qui, assurément de manière insatisfaisante, les protège mieux que n’importe quel autre régime politique.
Publié le 19 décembre 2018, Le Soir.